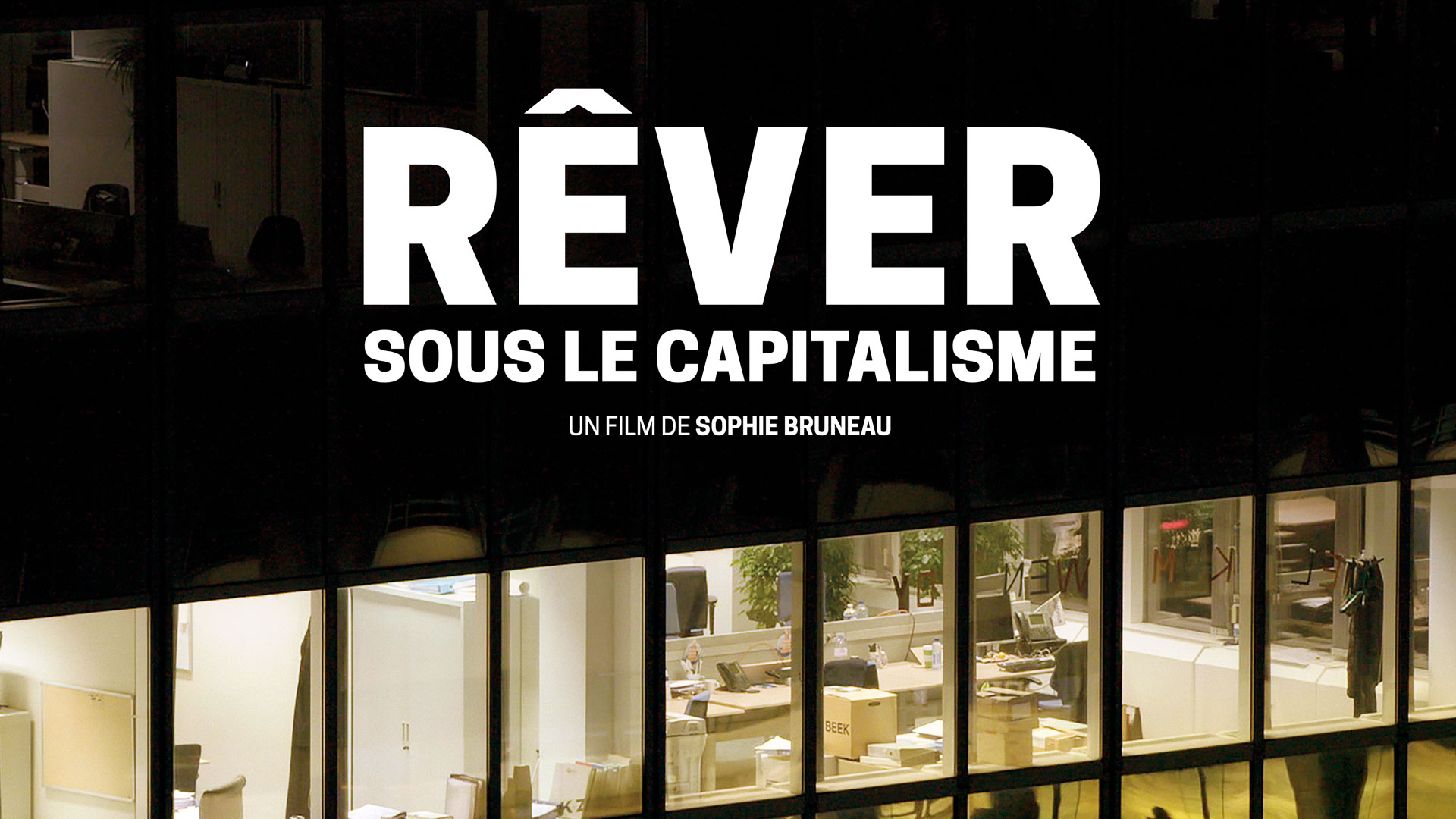Diffusion(s): Lu. 27/05 à 12h15
 Douze personnes racontent puis interprètent le souvenir d’un rêve de travail. Ces âmes que l’on malmène décrivent, de façon poétique et politique, leur souffrance subjective au travail. Petit à petit, les rêveurs et leurs rêves font le portrait d’un monde dominé par le capitalisme néolibéral.
Douze personnes racontent puis interprètent le souvenir d’un rêve de travail. Ces âmes que l’on malmène décrivent, de façon poétique et politique, leur souffrance subjective au travail. Petit à petit, les rêveurs et leurs rêves font le portrait d’un monde dominé par le capitalisme néolibéral.
Le rêve serait-il la voie royale d’accès à la connaissance du capitalisme ? Christophe DEJOURS*
« Rêver sous le capitalisme » est un film exceptionnel. Il est bâti sur un paradoxe : le pouvoir extraordinaire du cinéma, en effet, c’est de montrer des images animées. Et le rêve est avant tout un enchaînement d’images (sauf dans les cas rares où le rêve se réduit à une parole ou à des bruits). Or dans ce film Sophie Bruneau ne met pas en images les rêves qui lui on été rapportés. Elle respecte au contraire la caractéristique fondamentale du rêve : c’est qu’un rêve ne peut pas se montrer. Seul le rêveur peut voir son rêve, jamais personne d’autre que lui ne pourra le voir. Le rêve, définitivement, n’appartient pas au monde visible, parce qu’il appartient irréductiblement au monde subjectif. Images il est, invisible il demeure. Et quand on dit que seul le rêveur voit son rêve, c’est encore excessif: lui-même ne peut le voir qu’une seule fois, chaque réminiscence ultérieure le déforme, et il a de surcroît une fâcheuse tendance à se perdre, à s’estomper, à s’effacer. Comment peut-on seulement faire un film sur une matière invisible ? C’est pourtant le défi de cette œuvre.
La seule dimension accessible du rêve, c’est le récit qui en est fait par le rêveur. Ce film porte donc sur une matière non filmique : la parole, celle du rêveur. Et Sophie Bruneau a réussi à faire du cinéma sur de la parole, celle qui s’efforce de dire l’expérience subjective et invisible d’un rêve. De facto, elle renverse le dispositif cinématographique, puisqu’elle se sert du film pour convoquer le spectateur à un travail d’écoute, ce qui est fort déconcertant, à l’entrée du film. Peu à peu, pourtant, on est emporté par cet exercice, grâce à un maniement très particulier des plans fixes, sur des décors dont l’apparente banalité est énigmatique, alternant avec des séquences où l’on voit le rêveur racontant son rêve, et surtout parlant de son rêve.
« Sous le capitalisme » ? Qu’est-ce à dire ? Il y a un pré-supposé dans ce film : le capitalisme, dans un rêve, s’attrape par la voie du travail, en tant que le travail, lui aussi, est pour l’essentiel invisible. Car ce qui du travail appartient au monde visible, précisément, n’est jamais montré dans le film. Ce qu’il s’agit de saisir ici, ce n’est pas la partie visible de l’acte productif, mais la façon dont le rêveur se débat avec l’expérience subjective du travail, irréductiblement individuelle, cette expérience qu’impose à la subjectivité le fait de s’affronter aux difficultés du travail de production. Et c’est là que se situe la clef du film. Tous les rêves de ce film parlent du travail, et c’est en cela qu’ils disent en quoi consiste l’expérience du capitalisme. Je dis bien «expérience» du capitalisme. Il ne s’agit pas ici de rediscuter la question scientifique du travail comme opérateur d’intelligibilité du mode de production capitaliste. La question du film concerne la façon dont chaque subjectivité est affectée par le capitalisme. Et y répondre implique d’en passer par le travail vivant, parce que, comme le montre la clinique que Sophie Bruneau a étudiée dans un autre film (Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés), le travail ne se réduit pas au temps apparent de la production. Le travail vivant pénètre la subjectivité tout entière, il la mobilise au-delà de l’espace productif, il s’empare de la subjectivité jusque dans le hors-travail, jusque dans les insomnies, …jusque dans les rêves. Les rêves de travail, c’est peut-être au plus profond de soi le lieu même où le capitalisme vient estampiller la subjectivité.
Le rêve serait-il la voie royale d’accès à la connaissance du capitalisme ? Plagier ainsi la maxime de Freud, ne peut qu’être une erreur. Le rêve de travail serait plutôt la voie royale d’accès à la connaissance des formes dans lesquelles le capitalisme se fait une place dans l’inconscient de nos contemporains.
« Rêver sous le capitalisme », à l’instar du livre de Charlotte Beradt – « Rêver sous le nazisme » – est un document qui dépasse ce dernier, parce que Sophie Bruneau a filmé le rêveur parlant de son rêve et parfois associant sur son rêve. C’est un matériel clinique extraordinaire, c’est un tour de force, car on ne sait pas le secret de la relation qu’il a fallu bâtir entre la réalisatrice et le rêveur pour parvenir à ce résultat. Il faut le souligner, on ne peut pas accéder au sens d’un rêve directement. Pour y parvenir il faut en passer par les associations qui viennent à l’esprit du rêveur quand il pense ou raconte son rêve. Grâce à tout ce matériel rassemblé par Sophie Bruneau où se révèlent non seulement les paroles du rêveur, mais aussi ses mimiques, sa gestique, et plus largement la façon dont il engage son corps pour livrer son récit du rêve, ses commentaires et ses associations, grâce à tout ce matériel clinique donc, le spectateur peut commencer à réfléchir, à penser, à s’interroger sur sa propre expérience subjective du capitalisme et pas seulement sur celle des rêveurs du film.
Je mets ici un terme à ce début de réflexion sur le film : là où, pour chaque spectateur, commencera le travail personnel d’analyse auquel Sophie Bruneau appelle en quelque sorte tous ceux qui se demandent comment notre vie psychique est travaillée, en profondeur, par le capitalisme.
*Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers et directeur de recherche à l’Université Paris 5 René Descartes, spécialiste en psychodynamique du travail. Il est l’auteur notamment de “Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale.” (1998)